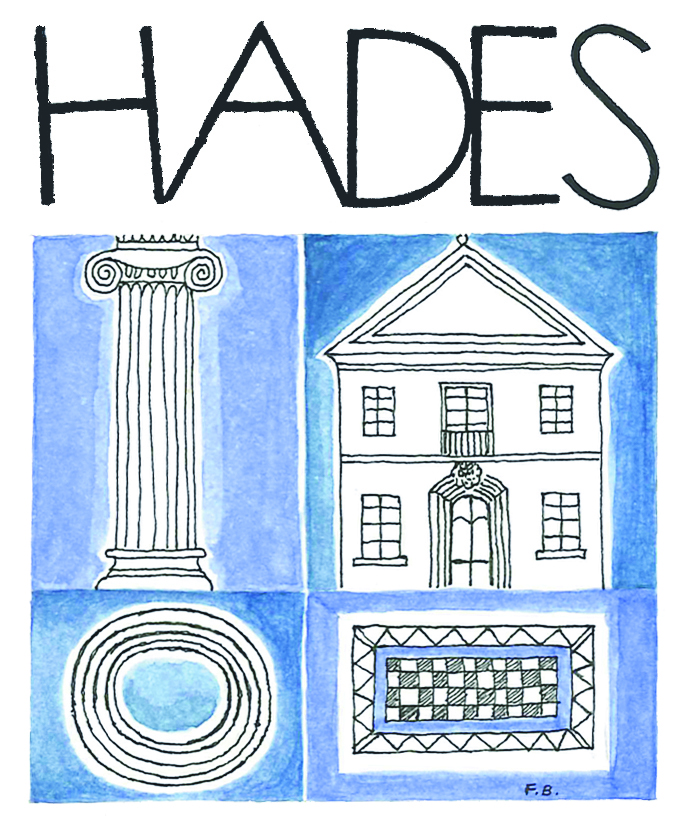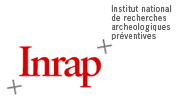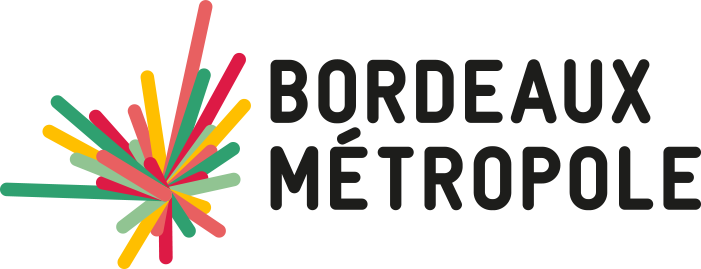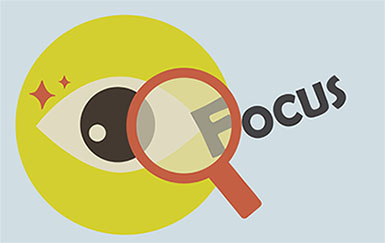A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
Henri ETCHETO

Axe de recherche Ausonius
- Textes, contextes, pouvoirs
Thèmes de recherche
- Les élites romaines d’époque républicaine et julio-claudienne : mécanismes et modes de reconnaissance, de domination et de légitimation sociales et politiques.
- Les « hommes nouveaux » et la noblesse romaine : concurrence, conformisme et ascension sociale et politique.
- Politique, propagande et écriture de l’Histoire : élaboration, transmission et influences des traditions historiographiques anciennes.
Cursus académique
- Capes : Histoire-Géographie (1994)
- Agrégation : Histoire (1995)
- Doctorat (Bordeaux 3) : « Les Cornelii Scipiones. Famille et pouvoir à Rome à l'époque républicaine » Jury : Jean-Pierre BOST (Université de Bordeaux 3) – Giovanni BRIZZI (Université de Bologne) – Marianne COUDRY (Université de Mulhouse) - Jean-Michel DAVID (Université de Paris 1 - Sorbonne) - Jean-Michel RODDAZ (Université de Bordeaux 3). Mention Très Honorable avec Félicitations - Prix Montaigne - (2008) sous la direction de Jean-Michel RODDAZ
- Master 2 (Bordeaux 3) : « Les peuples de la haute vallée de l'Ebre au temps de la conquête romaine » (1993) sous la direction de Jean-Michel RODDAZ
Qualification CNU - 21e section MCF
Parcours professionnel
- 1996-2000 et 2002-2014 : professeur agrégé dans l'enseignement secondaire (lycée et collège).
- 2000-2002 : A.T.E.R. à l’Université de Bordeaux 3 (U.F.R. d'Histoire)
- boursier à l'École française de Rome en 2000, 2001 et 2002.
- chargé de cours à l’Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA)
Publications
- Ouvrages Scientifiques (OS)
Les Scipions. Famille et pouvoir à Rome à l'époque républicaine, Bordeaux, 2012 (éditions Ausonius, collection « Scripta Antiqua » 45, 475 p.).
Résumé - Issu de la vaste gens Cornelia, le lignage des Scipions s’affirma entre le IVe et le IIIe siècle, notamment à travers des usages onomastiques et sépulcraux spécifiques qui contribuèrent à le distinguer désormais de la structure gentilice antérieure, en même temps qu’ils forgeaient une identité familiale puissante, fédératrice et durable qui inscrivait ses membres dans la solidarité et la continuité sur plusieurs générations. Occupant une position de premier plan au sein de la société aristocratique romaine au temps des guerres puniques, les Scipions livrent ainsi un exemple familial remarquable de l’expression sociale, des valeurs, des stratégies et des mentalités de la « meilleure » nobilitas d’époque médio-républicaine.
L’idéal social de la noblesse romaine était fondamentalement défini par la participation à l’exercice du pouvoir et à la politique. Les Scipions en offrent un exemple achevé qui révèle également l’importance de la structure familiale dans la vie publique romaine. L’implication précoce et constante des Scipions en faveur de l’extension de la puissance romaine contribua ainsi largement à renforcer l’identité familiale et à conforter l’influence sociale et politique des représentants de la famille. Mais au cours du IIe siècle, la cohésion lignagère s’effrita lentement et les rivalités et les dissensions familiales finirent par l’emporter sur la solidarité qui avait jusque-là prévalu, précipitant alors le déclin social et politique de la maison des Scipions.
Compte-rendus : Bryn Mawr Classical Review 2013-06-21 (Jesper Carlsen, University of Southern Denmark) ; L'Histoire n° 384 (janv. 2013) p. 105 ) ; Sehepunkte 2014-6 (Christoph Lundgreen, Universität Dresden).
- Articles dans des revues internationales ou nationales avec Comité de Lecture, répertoriées par l'AERES ou dans les bases de données internationales (ACL)
« Cognomen et appartenance familiale dans l’aristocratie médio-républicaine : à propos de l’identité du consul patricien de 328 av. J.-C. », dans Athenaeum 91, 2003, p. 445-468.
Résumé - L’enquête historique permet d'établir que le consul patricien de 328, P. Cornelius (Scapula, Barbatus ou Scipio, selon les sources) est le même personnage que le dictateur de 306, P. Cornelius Scipio Barbatus, le pontife Cornelius Barbatus signalé par Tite-Live (9.44.1-2) en 304, et le pontifex maximus P. Cornelius P.f. Scapula dont la tombe fut mise au jour à Rome en 1956. Le cas exemplaire de ce personnage permet d'éclairer les pratiques onomastiques de l'aristocratie patricienne à la fin du IVe siècle av. J.-C. : le cognomen n'était pas alors tout à fait fixé comme un élément invariable de la nomenclature individuelle ou familiale. Il était assez fréquent de voir un même personnage porter plusieurs cognomina successifs au cours de sa carrière, et transmettre ainsi à ses descendants une formule onomastique différente de celle dont il avait hérité. Plusieurs autres identifications difficiles s'éclairent alors pour cette période, dont celle de L. Papirius Cursor qui avait d'abord porté le cognomen de Mugillanus.
« La parenté de Cornelia Scriboniae filia et le tombeau des Scipions », dans REA 110-1, 2008, p. 117-125.
Résumé - L’examen des deux épitaphes les plus tardives du tombeau des Scipions (Ier s. ap. J.-C.) permet de trancher la question longtemps discutée de la parenté de Cornelia, la fille de Scribonia et soeur utérine de Julie, dont Properce honora la mémoire dans l’une de ses Élégies (4.11). Authentique descendante des Scipions, cette dame était la fille du consulaire L. Lentulus (cos. suff. 38 av. J.-C.). Elle mourut en 18 av. J.-C., l’année du consulat de son frère Cn. Cornelius L. f. Lentulus.
« Des Scipions plébéiens : l’origine familiale du tribun de la plèbe P. Cornelius Scipio (Orestinus) », dans ZPE 174, 2010, p. 241-242.
Résumé - Une inscription découverte au Vatican (A.E. 1992, 186) retrace la carrière de P. Scipio (Orestinus), tribun de la plèbe sous Auguste. Le statut plébéien de ce personnage doit s’expliquer par une « adoption testamentaire » qui lui aurait attribué le nom des Scipions mais pas la qualité de patricien. Sa famille de naissance était peut-être celle des Aurelii Orestes.
« Plébéiens ou patriciens ? Les cas des Cornelii Mamullae, des Cornelii Sisennae et des Cornelii Cinnae », dans RSA 40, 2010, p. 103-108.
Résumé - Les arguments les plus fondés inclinent à penser que les Cornelii Mamullae de l’époque médio-républicaine n’appartenaient pas au patriciat. Au contraire, les Cornelii Cinnae de la fin de la République continuaient, sans doute sous un autre cognomen, une authentique lignée patricienne de la gens Cornelia.
« Factio Tarquiniana ? Enquête sur les origines de la gens Cornelia », dans L’Antiquité Classique 81, 2012, p. 87-110.
Résumé - La gens Cornelia, l’une des plus prolifiques du patriciat d’époque républicaine, disposait visiblement d’une position politique éminente à Rome à la fin de l’époque royale. Probablement originaires du Latium, les Cornelii semblent avoir été redevables à la faveur des Tarquins de leur ascension sociale et politique, voire de leur introduction dans l’Urbs. La chute de la dynastie étrusque porta donc un rude coup à cette gens qui dut attendre vingt ans avant de revenir sur le devant de la scène politique romaine.
« Un « panthéon » rhétorique de la novitas : les hommes nouveaux de Cicéron », dans REA 116.2, 2014, p. 561-575.
Résumé - Les homines novi mentionnés par Cicéron dans ses discours n’étaient pas du tout choisis au hasard : l’orateur avait sélectionné avec soin une liste exemplaire des personnages les plus illustres afin de composer un « panthéon » symbolique qui avait vocation à définir et incarner un modèle social et politique destiné notamment à valoriser sa propre figure. C’est donc en tenant compte de la part de représentation subjective et des intentions personnelles de Cicéron, qu’il faut comprendre les éléments de définition de l’homme nouveau et de la novitas contenus dans ces textes.
[avec Fr. Jougleux] : « Les ressorts politiques d’une falsification historique : Cn. Domitius Ahenobarbus et les Ides de Mars », dans Historia 64-1, 2015, p. 106-130.
Résumé - Un réexamen du dossier permet d’arbitrer en faveur de la culpabilité, la question controversée de l’implication de Cn. Domitius Ahenobarbus dans la conjuration des Ides de Mars. Le témoignage de Cicéron paraît irrécusable à ce sujet. Condamné comme assassin de César au titre de la lex Pedia, Ahenobarbus ne dut sa disculpation et sa restitutio qu’à son ralliement opportun à Antoine qui cherchait des alliés au lendemain de la guerre de Pérouse. C’est Asinius Pollion qui négocia cette réintégration et qui finit par la faire accepter par Octavien lors des accords de Brindes. Pollion défendit ensuite cette version dans son ouvrage historique que Suétone et Appien utilisèrent plus tard, reproduisant ainsi la « vérité » devenue officielle de l’innocence d’Ahenobarbus.
« Cornelia, Asiageni filia, la « Troyenne » de Cicéron », à paraître dans Latomus.
Résumé - C’est bien Cornelia, l’épouse de Sestius, que Cicéron désignait sous le sobriquet de Teucris, « la Troyenne », dans plusieurs lettres adressées à Atticus à l’hiver 61 av. J.-C. Le sarcasme visait les prétentions généalogiques de cette dame, fille de L. Scipio Asiagenus (cos. 83) et descendante du vainqueur d’Antiochos à Magnésie qui avait pris ce cognomen, au cours de sa campagne asiatique, pour souligner le thème des origines troyennes de Rome et de sa propre maison.
Responsabilités administratives, scientifiques et pédagogiques
- membre du jury de l’agrégation externe d’Histoire (épreuve écrite d’Histoire ancienne) : sessions 2010, 2011 et 2012.
- collaboration éditoriale à la REA (Revue des Études Anciennes – Université de Bordeaux) : rapports d’expertise de manuscrits – comptes-rendus critiques de publications scientifiques.
Activités et publications de valorisation
« La gloire ternie de Scipion l’Africain », dans Histoire & Civilisations / National Geographic, n° 3, février 2015.
Dernière mise à jour : 2020-06-10 10:29:35