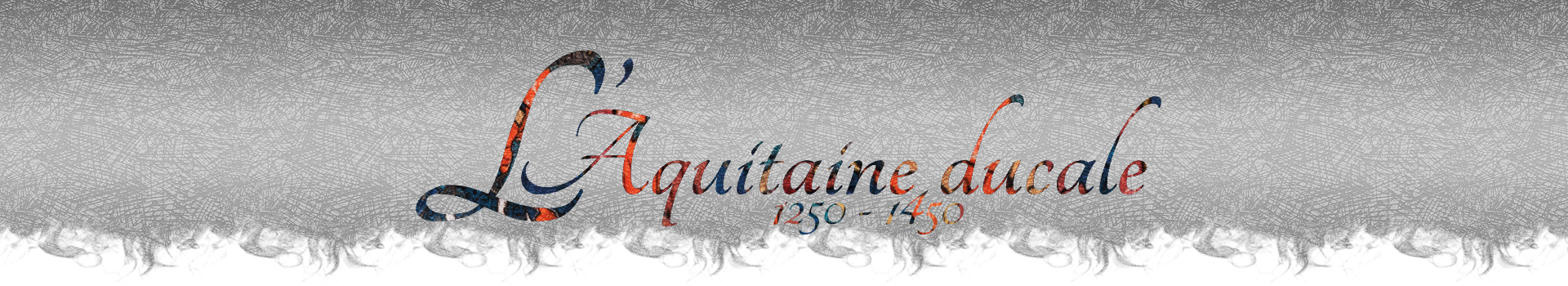Remparts de la bastide de Vianne (Lot-et-Garonne) |
|
Les bastides constituent un autre témoignage des progrès de l’administration ducale à l’échelle locale. Le mot gascon bastida apparaît à de nombreuses reprises dans les Rôles gascons. Les bastides sont ces villes nouvelles caractéristiques du Sud-Ouest de la France et dont les vestiges ont été conservés jusqu’à nos jours (Sauveterre-de-Guyenne, Créon, Libourne ou Monpazier représentent de bons exemples de fondations anglaises). Parfois ceintes de remparts à l’image de Vianne (Lot-et-Garonne), ces cités se distinguent par un règlement d’urbanisme plus ou moins rigoureux où toutes les habitations sont organisées autour d’une place centrale et dont le modèle le plus abouti est celui du plan en damier (des voies parallèles se développent à partir de deux axes perpendiculaires).
|
| |
La création d’une bastide suit des étapes précises. Il faut avant tout déterminer son emplacement et, si le fondateur n’est pas le seul maître du lieu, conclure un contrat de paréage avec entre les différents seigneurs locaux (partage des pouvoirs et des revenus de la bastide). Une charte de fondation est ensuite rédigée afin d’établir un plan d’urbanisme et de fixer les limites administratives de la ville. Cet acte est aussitôt suivi d’une charte d’établissement des coutumes et libertés concédées aux habitants du nouveau bourg et dont l’objectif est d’attirer les populations environnantes et garantir leur fidélité. Ainsi, le 25 octobre 1321, à la suite d’une pétition envoyée par les autorités de Dax et Bonnegarde, Édouard II (1307-1327) fait confirmer et préciser les coutumes de la bastide de Hastingues (Landes) qui fut fondée en 1289 par le sénéchal de Gascogne John de Hastings (C61/35, 15-17, membrane 19, 18). Parmi les nombreux articles de ce texte, retenons que les habitants d’Hastingues ne peuvent être soumis à aucune taxe ni fouage (impôt extraordinaire) à moins qu’ils n’y consentent, peuvent librement disposer de leurs biens, ne peuvent être arrêtés et emprisonnés qu’en cas de crime capital (comme le meurtre), ne peuvent être jugés en dehors des limites administratives de la bastide, peuvent disposer d’un four personnel et sont exemptés du service militaire durant dix ans. À ces privilèges s’ajoutent ceux d’organiser deux foires par an (d’une durée de huit jours) et un marché au mois de mars, d’être exempté des taxes sur les ventes et achats, de posséder un sceau municipal et d’élire annuellement six jurats chargés d’administrer la ville sous la surveillance d’un agent du roi-duc, le bayle. Les jurats peuvent exiger la participation des habitants aux travaux publics (entretien des routes, des ponts, des fontaines etc.) et peuvent lever un impôt en cas de nécessité. En matière de justice, une hiérarchie stricte est établie entre les différentes amendes pour délits : par exemple, les fausses allégations sont punies de 6 sous de monnaie de Morlaàs alors que l’amende pour adultère s’élève à 100 sous (la somme la plus élevée indiquée dans le document). Pour satisfaire les revendications de Dax et Bonnegarde, les limites de la juridiction d’Hastingues sont aussi précisées : elles s’étendent de la rivière (les Gaves réunis) à la Bidouze et au pont de Lahire, et du lieu appelé « ad fossam de Bideng » jusqu’à l’embouchure de la Bidouze. Les personnes ne relevant pas de l’autorité du roi-duc mais vivant sur ce territoire bénéficient notamment d’un droit de pâture et de ramassage du bois. Enfin, des informations précieuses sont fournies en matière d’urbanisme puisque la division du territoire en lots individuels est mentionnée : chaque habitant de la bastide dispose au choix d’une terre de 12 aunes de largeur sur 30 de longueur ou de 12 aunes de largeur sur 44 de longueur (l’aune vaut 1,191 mètre dans la région des Landes).
Ce document particulièrement riche met en lumière un problème caractéristique des fondations de villes neuves : les empiètements de la juridiction du roi-duc sur les domaines de ses vassaux. Cette question est à mettre en relation directe avec la principale fonction des bastides : l’affirmation territoriale de l’autorité ducale. Contrairement à une théorie communément répandue, les bastides de Guyenne n’ont pas été créées pour défendre la frontière séparant le royaume de France des possessions anglaises. C’est parce qu’elles ont été fondées sur des zones de marges que certaines ont fini par jouer ce rôle défensif – et non l’inverse –, comme l’illustre parfaitement le cas de la bastide de Cadillac (Gironde). Fondation privée datée de 1280 (une initiative du vicomte de Benauges, Jean Ier de Grailly), Cadillac n’obtient le droit de construire des remparts qu’en 1366. Sa vocation militaire apparaît donc bien comme secondaire. Associée au château voisin, la cité nouvellement fortifiée devient de fait une puissante place-forte qui subira plusieurs sièges et sera la dernière à se rendre aux Français en novembre 1453.
|
Cadillac est représentative de la majeure partie des bastides anglaises : leur fortification – quand elle a lieu – intervient souvent plusieurs décennies après leur fondation, non par ordre du roi-duc mais à la demande insistante des habitants. Financés par les municipalités (le roi-duc peut néanmoins consentir à prendre en charge la construction des portes), ces remparts ont surtout vocation à défendre les bastides contre des agressions locales. Les textes évoquent ainsi des actes de brigandage, des combats, des usurpations et des emprisonnements arbitraires commis non pas par des armées ennemis mais par les voisins directs des bastides. Ces agissements résultent des actions de seigneurs lésés ou envieux, de conflits de juridictions entre deux bourgs (Vianne et Lavardac ont longtemps lutté) ou encore de truands devenus nombreux dans les campagnes à la suite des guerres et des famines. Agressée à plusieurs reprises, la bastide de Montréal-du-Gers cristallise les mécontentements de son voisinage. Le conflit est évoqué par deux documents des Rôles gascons.
|
|
Fortifications de la bastide de Cadillac
|
|
En 1318, les habitants de la bastide sont attaqués par des hommes du comte d’Armagnac et du vicomte de Brulhois. Les dégâts sont considérables : onze morts, bétail volé (des chevaux sont notamment cités), biens meubles pillés, emprisonnements, viols, enlèvements de femmes, extorsion d’argent et destructions diverses. Édouard II intervient une première fois le 8 novembre 1319 en exigeant une enquête sur ces déprédations perpétrées sur ses sujets (C61/33, 13-14, membrane 15d, 46). Les méfaits du comte d’Armagnac et du vicomte de Brulhois étant renouvelés, le roi d’Angleterre ordonne au sénéchal de Gascogne, le 8 mai 1320, de rétablir la paix au plus vite et d’indemniser les habitants de Montréal. Le sénéchal est même accusé par Édouard II d’avoir négligé le règlement de cette affaire (C61/33, 13-14, membrane 19, 173).
|
Édouard II intervient une première fois le 8 novembre 1319 en exigeant une enquête sur ces déprédations perpétrées sur ses sujets (C61/33, 13-14, membrane 15d, 46). Les méfaits du comte d’Armagnac et du vicomte de Brulhois étant renouvelés, le roi d’Angleterre ordonne au sénéchal de Gascogne, le 8 mai 1320, de rétablir la paix au plus vite et d’indemniser les habitants de Montréal. Le sénéchal est même accusé par Édouard II d’avoir négligé le règlement de cette affaire (C61/33, 13-14, membrane 19, 173).
Ces multiples conflits sont la conséquence directe des conditions de fondation des bastides. En s’appropriant des territoires jusque là livrés à un enchevêtrement de droits confus et privés, les rois-ducs réveillent l’animosité de leurs vassaux. Cependant, les bénéfices (politiques et financiers) tirés de ces villes neuves supplantent largement les difficultés liées à leur établissement.
|